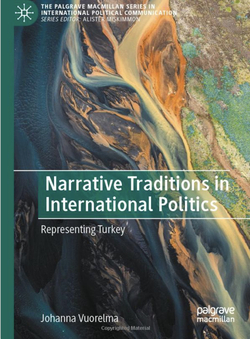 Frappée par le contraste entre la Turquie décatie qu'elle avait découverte dans les livres avant de s'y rendre et la Turquie vigoureuse qu'elle a vue sur place, Vuorelma a traduit cette contradiction dans un livre dans lequel elle analyse en détail ce prétendu problème des médias, de l'analyse politique et de l'opinion publique. Pour être plus intelligible, le titre du livre aurait pu être : « Un siècle de stéréotypes étrangers sur la Turquie ».
Frappée par le contraste entre la Turquie décatie qu'elle avait découverte dans les livres avant de s'y rendre et la Turquie vigoureuse qu'elle a vue sur place, Vuorelma a traduit cette contradiction dans un livre dans lequel elle analyse en détail ce prétendu problème des médias, de l'analyse politique et de l'opinion publique. Pour être plus intelligible, le titre du livre aurait pu être : « Un siècle de stéréotypes étrangers sur la Turquie ».
Chercheuse à l'Université d'Helsinki, l'auteure livre son point de vue dès la page 3 en citant Edward Said dont elle prend le parti sans jamais s'en écarter le moins du monde. Ainsi, les textes sur lesquels elle s'appuie à propos de la Turquie « sont lus comme des descriptions non seulement au niveau international mais aussi au niveau même de l'Occident ». Elle s'intéresse beaucoup plus à « la communauté épistémique vaguement formée des journalistes, des universitaires, des diplomates et des politiciens » qu'à Atatürk et Erdoğan.
Vuorelma divise l'époque étudiée en cinq parties (jusqu'en 1952, jusqu'en 1991, jusqu'en 2003, jusqu'en 2011 et depuis 2011) mais celles-ci importent moins que « quatre traditions narratives » qui, selon elle, sont « déjà observables au début des années 1900 » et toujours présentes aujourd'hui. Cette continuité « montre que les croyances qu'ils portent sont profondément ancrées et tenaces ». Ces traditions présentent « la Turquie comme un pays (1) que "nous" sommes potentiellement en train de perdre, (2) occupant une position stratégique, (3) dirigé par des hommes forts incarnant l'État, et (4) constamment menacé par un islamisation rampante ».
Analyse apparemment perspicace. Toutefois, cette thèse est réfutée de façon magistrale par Matthew deTar qui, dans une étude d'une qualité bien supérieure et intitulée Figures That Speak: The Vocabulary of Turkish Nationalism (Syracuse: Syracuse University Press, 2022), affirme que les continuités de l'histoire turque sont bien une réalité et pas seulement le résultat d'une compréhension limitée de la part des étrangers. Comme le résume la notice de son livre : « Si en surface, la politique turque a radicalement changé au fil des décennies, le vocabulaire servant à sérier ces changements demeure constant : l'Europe, l'Islam, les minorités, l'armée, le père fondateur (Atatürk). »
En plus de sa thèse erronée, Vuorelma déforme les écrits de son échantillon pour les faire entrer dans le moule des quatre rubriques. À titre d'exemple, prenons un article paru en 1994 dans le National Interest, "Islam's Intramural Struggle", et qu'elle évoque dans son ouvrage, un article que je connais bien puisque j'en suis l'auteur. Vuorelma affirme que « les croyances caractéristiques de la tradition narrative sur "la perte de la Turquie" sont présentes dans l'analyse de Pipes ».
Or, il suffit de jeter un œil sur mon article pour voir que c'est tout le contraire. Je présente la Turquie (d'avant Erdoğan) comme un pays regorgeant de « musulmans confiants dans le fait d'apprendre des étrangers, orientés vers la démocratie et prêts à s'intégrer dans le monde ». Je décris la Turquie comme jouissant « d'une philosophie de la laïcité particulièrement élaborée et largement acceptée » et servant de « magnifique réussite dans le monde musulman ». De plus, « le modèle turc menace de saper l'expérience khomeiniste tout comme le modèle occidental a finalement sapé l'expérience soviétique. » J'appelle les Turcs « à imiter les mollahs en diffusant leurs propres idées dans le monde musulman » et Washington « à encourager les Turcs à rester forts ». Bref, j'appelle les Turcs à promouvoir leurs idées avec plus de force. Le thème de « la perte de la Turquie » est ici introuvable, sauf dans l'imaginaire de Vuorelma.
Vuorelma a façonné un moule et, comme trop d'universitaires, elle écarte tout ce qu'elle ne peut pas faire entrer dedans.

